JACQUES RICHARD
Peintre et écrivain bruxellois. Peintures récentes et portraits. Littérature : "L'homme, peut-être", "Petit traître", "La Plage d'Oran". Atelier à Bruxelles. Voir aussi : http://www.galeries.jrichard.be.
Critiques littérature
« Le bourreau tue dans l’autre ce qu’il pense » ✶✶✶
Avec « Le Carré des Allemands », Jacques Richard s’impose dans le paysage littéraire belge
Le Soir Samedi 13 et dimanche 14 février 2016
Les livres
ENTRETIEN
Ce livre est aussi court (141 pages) qu’il est fort. Ecrit dans une langue déliée, subtile, tantôt svelte tantôt grave, qui joue sur les métaphores et se mue parfois en poésie pure. L’histoire est pourtant tout ce qu’il y a de plus prosaïque. C’est un homme qui cherche son père, dont il est séparé depuis l’enfance et dont sa mère ne parle pas, et qui comprend petit à petit qui il fut. C’est ce père qui s’engage à 17 ans dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui se transforme en Waffen SS, qui fuit à la Libération, emmène sa famille ailleurs pour, enfin, s’évaporer. C’est l’histoire d’un
choix. Ce jeune type qui pose un acte fort, qui s’engage pour casser du communiste. Et l’histoire du jugement moral de ce choix.
Vous ne jugez pas l’homme de cette histoire, vous la dites, simplement.
Il faut essayer de comprendre plutôt que de juger. On n’est pas à la place des gens pour juger d’un combat qui, pour eux,
était le bon... ou le mauvais. Ce livre n’est pas un rachat des gens de la Légion Wallonie, par exemple, qui ont fait le mauvais combat. C’est juste qu’à travers le choix du père de mon roman, je cherche ce qui en moi aurait pu être celui-là, d’où le sous-titre Journal d’un autre. L’autre qui est en moi, que chaque protagoniste est oupourrait être. Une amie m’a
dit : cet autre, qui est-il ? J’ai répondu : mais... c’est toi !
C’est poser la question : qu’aurais-je fait à la place de cet homme ?
Est-ce qu’on choisit vraiment, quand on a 17 ans ? C’est vrai qu’on est lucide à cet âge, mais on n’a pas toutes les armes du choix. Estce qu’on les a d’ailleurs jamais ? Est-ce qu’on ne reste pas toujours quelqu’un qui a 17 ans ? D’où ma phrase : « Tous les moi que je suis, enchâssés l’un dans l’autre. »
Ce qui signifie ?
Depuis le tout premier moi dont j’ai eu conscience. C’est comme les poupées russes ou un oignon : chaque pelure
vient s’ajouter, une pellicule deplus en plus dure et protectrice, mais l’intérieur reste ce qu’il a été. Et à 17 ans on choisit parce qu’il y a une pression sociale, le métro, le boulot, la pauvreté monstrueuse dans laquelle des gens sont, les laissés-pour compte qui vont chercher une identité imbécile, bidon. Le père de mon roman s’engage contre le communisme dont il ne connaît rien. D’autres, aujourd’hui, vont le trouver dans un pseudo-islam contraire à la pensée musulmane.
Vous écrivez : le bourreau aussi est à la place de la victime.
Chaque fois qu’un bourreau frappe un coup, il est un peu plus en dehors du monde, il est la victime de lui-même. Le
bourreau sait qu’il est un monstre, il sent dans sa chairce que l’autre sent dans la sienne. Le bourreau sait tout. C’est son propre corps qu’il flagelle en étant bourreau.
Vous parlez là de la Guerre 40-45, mais ça s’applique à tous les conflits.
C’est le fait de combattre l’autre tout court, d’avoir affaire à l’autre parce qu’il est autre. C’est ce qui s’est passé avec
Charlie, au Bataclan. On tue dans l’autre ce qu’il pense. Pas ce qu’il pense différemment : ce qu’il pense tout court, parce que penser c’est par définition penser différemment.
Vous écrivez aussi que la faute du père écrase le fils.
On peut accepter ou refuser un héritage. Dans les deux cas, on y a affaire. La faute du père rejaillit. Si on accepte un père, on accepte qu’il soit ça, même si ce qu‘il a fait nous révulse. Comme le narrateur de mon roman, on cherche son père jusque dans la tombe. Et, au delà, ce qu’on cherche, c’est soi-même. On se demande en quoi on est son héritier. Et on n’est jamais sûr qu’on n’aurait pas fait la même chose que lui.
Votre livre tient à la fois du roman et de la poésie.
Je revendique plutôt le fait qu’il y ait de l’écriture, qu’elle soit narrative, poétique, presque journalistique parfois. Je voulais que le total fasse un « dire », pas une narration. Celle-là peut se lire en filigrane, mais elle n’est pas chronologique, elle fait appel au flashback. Le nouveau roman nous a appris à avoir un langage différent de la linéarité, et je tiens à cela : c’est une forme de liberté, une pluralité du discours qui me semble mieux éclairer le propos.
Propos recueillis par
JEAN-CLAUDE VANTROYEN
par Stéphanie de Saint-Marc
En attendant Nadeau n°4, le 24 février 2016
Roman, comme l’indique la couverture ? Journal, comme le dit le titre ? Le carré des Allemands : Journal d’un autre, le bref texte de Jacques Richard, est en tout cas d’une force peu commune et fait entendre un « je » puissamment nourri de vécu, intensément vibrant et présent, familier dans sa chair du rôle du bourreau et de l’expérience du mal.
Jacques Richard, Le carré des Allemands, Journal d’un autre. Éditions de la Différence, 146 p. , 17 €
Le carré des Allemands est le livre d’une fuite et d’une quête impossible. Un fils cherche son père disparu. Un père fuit son foyer, ailleurs, plus loin, toujours plus loin, dans le but d’échapper à l’emprise d’une faute indicible. L’un et l’autre sont semblables, marqués tous deux de malheur et de culpabilité. On apprendra comme au détour des pages que le fuyard fait partie de la LVF pendant la guerre – 638e régiment d’Infanterie de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme – puis que, rescapé, il est versé en renfort de la Waffen-SS. Aide-bourreau des Juifs. « Quels enfants as-tu assassinés pour fuir, après, sous le regard des tiens ? Qu’est-ce donc que tu as fait pour que le tien d’enfant ne puisse rien d’autre que s’enfuir à son tour ? », interroge le fils.
À quoi ressemble un bourreau ? À quoi ressemble un homme pris dans un système de mort ? Jacques Richard, par touches, trace son portrait. D’où vient celui-ci et quelle est son histoire ? Par bribes, par éclairs de conscience successifs, le fils raconte son père en parlant de lui-même, sondant les zones les plus sombres que l’un et l’autre portent en eux comme des prisons. La fascination de la mort. Le poids de la faute.
Le narrateur vit aujourd’hui quelque part dans une ville en territoire flamand. Reclus, il occupe une chambre-cave en entresol, une fenêtre donne sur un centre psychiatrique, des jambes passent dans la rue… Une femme au visage masculin, connue dans la jeunesse et retrouvée à l’âge adulte, rencontre la trajectoire de cet homme solitaire. Avec elle, il reconstitue les pièces du puzzle : le père, la mère fuyant la France après la guerre pour traverser la Méditerranée. Enfant, l’Afrique, l’Algérie, et, là, le père volatilisé, disparu dans la tourmente des « événements », puis plus jamais revu. Auprès de cette femme aux traits anguleux revenue du passé, il se souvient. Le trouble sexuel de son adolescence, la présence singulière, hardie, de la fille qu’elle était, le goût de transgression, de sueur, de salive mouillée de gitane auquel elle est associée. Leurs jeux de regards, ce qu’ils offrent et ce qu’ils retiennent. L’excitation de la mort, aussi, donnée à des chatons sous les yeux de la fille. Sexe et mort confondus sous un même regard.
Dans une écriture trouée de silences, par des mots crus parfois, Jacques Richard retrace au fil d’une chronologie bouleversée l’itinéraire d’un fils en quête de son père, entre absence et présence. Celui d’un fils qui peut dire : « Et s’il revenait il faudrait que je meure ou bien que je le tue ». Celui d’un fils qui peut dire encore : « Et s’il revenait, il faudrait qu’il m’embrasse, me serre dans ses bras. Ou alors qu’il m’achève. » À travers un destin original, ce livre tâtonnant, d’une intelligence aiguë, explore comme en tremblant les territoires obscurs qui habitent chacun de nous.
Stéphanie de Saint-Marc
Jacques Richard, peintre de l’innommable
Publié le 14 février 2016
Un chat et une amie, romancière et professeur, entourent le solitaire misanthrope qui prend la parole dans le premier roman de Jacques Richard. Ce peintre belge a déjà publié des nouvelles qui ont été, quoique tardives dans sa vie, remarquées par la critique pour leur étrangeté et leur ton inquiétant. Les peintres écrivains sont le plus souvent poètes, et c’est plus de poème que de roman que l’on devrait parler pour qualifier Le Carré des Allemands. Le titre sera expliqué à l’avant-dernière page, où le narrateur vient se recueillir sur la sépulture de son père, qui n’est pas à proprement parler une tombe, mais la fosse commune près du coin où furent enterrés, on l’imagine, des soldats allemands.
Le livre tout entier se présente, en cinq carnets, non pas comme un récit continu, mais comme une suite de scènes fragmentaires, dont on n’identifie pas tout à fait le contexte ni même les protagonistes ni même les voix. On ne sait pas de manière très certaines qui sont les locuteurs. Mais on en retient un autoportrait, dans le sens très pictural du terme, car de peinture il est question, et des tableaux saisissants, bribes de conservations de cafés, dialogues avec l’enseignante qui est la confidente privilégiée, réminiscences d’une ferme, et, de façon lancinante, la hantise de ce père qui a abandonné sa famille pour suivre en Russie les Allemands. Est-il revenu ? Est-il reparti ? Ce fantôme fuyant vient, en tout cas, régulièrement visiter les rêves et les réflexions du narrateur solitaire et nourrir ses conversations.
On aurait tort d’imaginer que le récit, du fait de sa fragmentation et de son montage syncopé, est obscur. Il est, certes, très sombre et parfois flou, mais il en résulte une atmosphère envoûtante qui ne tient pas seulement au sujet, qui est une enquête sur un homme qui s’était engagé dans les Waffen SS, et qui peut-être tua des enfants, bref sur un monstre, mais au style réflexif qui, sans être alambiqué, sans être affecté, a une forme inattendue, celle que choisissent en général les poètes qui se battent avec les mots, plus qu’ils ne les utilisent pour raconter. Le flou du regard, qui plonge la réalité tout entière dans une sorte de lointain, recouvert d’une « patine », qui, selon Pasolini, était la caractéristique de Giorgio Bassani, ressemble, bien sûr, au point de vue d’un peintre qui a besoin de distordre le réel pour l’approcher de lui et de nous.
Le narrateur est très conscient de la particularité de ce regard et de cette narration, qui le trouble au point de craindre de côtoyer la folie. Du reste, les passants qu’il croise sont des fous qui vont et viennent dans un hôpital psychiatrique voisin. Et quand ce sont des amis, des visiteurs, il semble que le langage ne soit pas le vrai contact qui les unit, eux et lui. « Je me regarde en eux comme on se penche au-dessus du vide. On n’a pas en permanence la pleine conscience de ce qu’on est. Encore moins de ce que sont les autres. Si c’était possible, il y faudrait une capacité d’attention dont je suis dépourvu. La mienne flotte trop et dérive d’un rien. C’est une sorte de maladie, je suppose. »
Quant à la réalité elle-même, celle qui l’entoure, celle qui l’a précédé, celle qu’il regarde et celle qu’il fouille en lui, elle n’a pas une solide consistance, elle s’évapore. C’est précisément parce qu’il a le sentiment que toujours quelque chose lui échappera et du reste échappera à ceux qui l’observent, lui, qu’il écrit et redouble ou varie son art de peintre. « J’accoste trop tôt dans le gris du réel qui n’est jamais qu’un rêve à peine plus épais. »
Parmi les voix que l’on entend dans ce livre choral, il en est une de particulièrement frappante, celle de la tante, la sœur du père, qui, pour son neveu, commente le passé, des photos, des anecdotes. Dans son monologue haletant, entrecoupé de visions et d’incertitudes, on revoit son frère, à la manière qu’avait Duras dans certains monologues (de l’Amante anglaise, de Savannah Bay, d’India Song) ou dans La Douleur, de faire revivre des instants de cruauté pure et d’amour parfois confondus. On sent qu’on est dans une zone où la morale n’a plus court. Même pour évoquer l’atrocité.
32e798d23f-hpe-web2Ce n’est que lorsque le narrateur prend lui-même la parole que la frontière qui sépare le bien et le mal est plus ferme. Mais peu à peu, il en revient à une dislocation de sa propre personnalité, comme si l’obsession de son père criminel, pas si criminel que cela, à en croire sa tante, était le moyen de prendre conscience de sa propre dissolution : « Les supplices illustrés avec la minutie maniaque des Flamands du Moyen-Âge servaient exactement à ça : exhiber l’innommable, l’ignoble, l’intérieur d’un homme. Il s’agit de défaire, de dépecer, de découdre les autres autant que nous nous savons décousus. Il s’agit d’en découdre avec l’autre moi-même, ce moi-même qui est l’autre. »
Les scènes violentes qui soudain traversent le texte (infanticides, viol, ou simplement scènes sexuelles sans amour, qu’il s’agisse de suppositions sur la vie du père ou de fantasmes du narrateur), l’agonie reconstituée avant la visite à la fosse commune se substituent à ce que serait une véritable investigation réaliste. On sait que l’auteur ne veut pas être un simple témoin, ni un inquisiteur. Ce n’est pas un souci de vérité ou de vengeance qui l’anime. Autre chose. Une sorte de contamination onirique. « Se voir tuer, ramener à la surface ce qui crie dans le noir et le faire en plein jour. »
René de Ceccatty, écrivain, éditeur.
Le Carré des Allemands, journal d’un autre
de Jacques Richard
Editions de la Différence, 142p., 17€
« Tu lui ressembles tant »
Il y a différents types de cimetières. Loin des Vallées des Rois et des Reines, des croix blanches militairement alignées et des nécropoles aujourd’hui virtuelles, ceux de nos contrées se ramifient souvent en allées rectilignes et sentiers tortueux, entre gravier et poussière. Le long
des caveaux en floraison ou en abandon, nous percevons rapidement une organisation singulière : une partie ancienne, des tombes modernes, des lopins dévolus à telle ou telleconfession, des rassemblements communautaires post-mortem, une pelouse cinéraire. Et, au fond, tout au fond, un peu cachée, parfois une fosse commune. Le carré des indigents dans lequel sont enfouies les petites misères et ensevelis les grands secrets, de ceux qui engendrent les questionnements de toute une vie, de toutes les vies. Le narrateur du Carré des Allemands en sait quelque chose. C’est un homme dont la presbytie trahit les ans et qui loge dans une « cuisine-cave » avec vue sur le trottoir. Comme il « n’aime pas la ville le jour » ni « [l]e bruit, les voitures, la sottise dangereuse », il se claquemure dans cette pièce et, à travers l’écran de sa fenêtre, il observe les passants en rue et les visiteurs de l’hôpital psychiatrique d’en face : « Sacs en plastique, bouquets à deux sous. Les gens passent à hauteur de mes yeux et ils n’ont pas l’air tellement plus réels que la lueur des images criardes et changeantes qui tressaute sur les murs nus de ma chambre. » En retrait permanent, il ne fuit pas pour autant : il cherche. Lui, l’« engeance de malheur », est en quête de sa propre identité, mais surtout de la figure paternelle, de l’absent. « Tu lui ressembles tant. » Cette phrase massue, assénée à de multiples reprises, charrie son lot de mystère et de culpabilité. Et lamine l’âme. Mû par l’appel du vide, le « je » tente alors (vainement) de reconstruire cette dimension qui lui échappe. Suivant les sinuosités d’un passé boueux, il se crotte, s’englue, s’éreinte à garder la trace d’un père dont la destinée a été infléchie par un engagement auprès des « Boches » à l’âge rimbaldien du non-sérieux. Au fil de cinq carnets et de pérégrinations spatio-temporelles,
le narrateur dissèque l’insaisissable, et s’abstient de tout jugement. « On ne sait pas ce que font ceux qui ne sont pas là. Moins encore ce qu’ils sont. Ceux qui vivent sous nos yeux, déjà, nous sont si mystérieux, tellement indéchiffrables. C’est sans doute cela qui nous les rend précieux. »
Et, si l’uniforme ne fait pas le soldat, il marque néanmoins une frontière invisible séparant ceux qui sont et ceux qui s’efforcent à être…
Celui qui rédige ce Journal d’un autre affiche une incapacité à vibrer au même diapason que les gens à son entour. Que ce soit dans les cercles sociaux ou l’intimité d’une relation, il donne le change. Une existence entière à se refléter fragmentairement dans le regard d’autrui. Il n’y a
bien que devant le matou amoché qu’il a vaguement recueilli, qu’il est libre de ne pas tenir un rôle fissuré et d’être lui-même… Ne trouvant aucun répit dans le sommeil non réparateur, la nuit, il marche dans la ville, fréquente les salles de cinéma, goûte aux passes tarifées, discute
avec les patrons de bar. Mais, au final, il se voit immanquablement rattrapé par ses pensées identitaires en spirale : « Être un autre. Tous ceux que j’ai été, que je ne serai pas et tous ceux que je suis. Être un autre. Être Noir comme un roi, être Arabe par amour, Juif six millions de fois. Être une femme qu’on aime ou une qu’on lapide, être un autre et connaître chacun de tous les autres à l’intérieur de moi, chacun de tous les moi à l’intérieur de l’autre. » Jacques Richard sonde ici les rapports filiaux, les fardeaux honteux, les destins souillés. Dans une prose sobre, il brouille, par des formules désarmantes de justesse et des silences suspendus, les portraits d’un père et d’un fils : « Il est tout seul. Je suis tout seul. Je suis le genre humain traînant au milieu de rien. Il faudrait dire “il” mais lui, c’est aussi moi. C’est moi autant que je suis “il”. Sujet de quoi ? […] Je suis et fils et père. » Richard ne nous raconte pas une histoire, il nous fait entendre une voix. Dans ce récit troublant, où les échos familiers se mêlent aux dissonances énigmatiques, les enfants perdent brutalement leur innocence, les non-dits dissimulent la cruauté de l’attente, et les chats errants nous honorent de la mort. Point de salut dans ce texte fort, seul un espoir confus de résilience : la non-légitimité est une concession à perpétuité.
Samia HAMMAMI
RICHARD Jacques, Le Carré des Allemands. Journal d’un autre, Éditions de la Différence,
2016, 146 pages, 17€.
L'écritoire des Muses : lecritoiredesmuses.hautetfort.com/archive/2016/01/16/le-carre-des-allemands-5746078.html
Livre émouvant, bouleversant...
Cinq carnets : une voie indirecte, détournée pour raconter un passé, se raconter, mettre à nu l’Autre et soi-même, creuser au plus profond de l’intime, du secret, en tricotant et en superposant le passé et le présent, en le disant, en l’imaginant, pour arriver à comprendre l’Autre et à se comprendre. Cinq carnets : des petites notes écrites, dépourvues de grandiloquence permettant de pénétrer l’intimité la plus banale du narrateur - psychique, psychologique et même physique - : « Du blême de mes deux cuisses nues surgissent des poils encore bruns. Mes avant-bras y ont imprimé deux ovales plus roses parce que je m’appuie sur mes fémurs pour lire des haïkus dans les toilettes ». Une nouvelle forme d’écriture conciliant langage parlé et recherché, poésie, extime et intime. Tout ce qui se joue dans Le Carré des Allemands de Jacques Richard touche à l’identité, creuse les arcanes des racines personnelles, quête primordiale insoutenable.
Dans Le Carré des Allemands - une fiction fondée sur le réel -, un fils, professeur, habitant une ville flamande, parle de son père au passé secret, parti lorsqu’il était enfant : « Qu’a-t-il fait à la guerre, Papa ? ». La réalité voilée sera dévoilée progressivement. En évoquant cette énigme que constitue son père, il parle aussi de lui, de bribes d’Histoire, de l’humaine condition : « Je suis le genre humain traînant au milieu de rien. Il faudrait dire ‘il’, mais lui, c’est aussi moi. C’est moi autant que je suis ‘il’. Sujet de quoi ? Je suis le genre humain traînant parmi la neige, traînant parmi les fleurs des poèmes anciens et leurs couleurs, encore, sont celles de l’aurore. Je suis et fils et père ». « Je est un autre ». Des forces incontrôlable habitent l’être humain et, comme chez le poète, grâce à cet Autre, l’œuvre d’art, ici le roman, naît.
Le narrateur éclaire le présent à la lumière du passé et le passé à la lumière du présent. Des fragments de sa vie et de celle de son père jamais à sa place ni dans la vie ni dans la mort (« Il y a, même dans la mort, des places qui n’en sont pas »), des captations d’instants s’entrelacent. Les deux êtres ne font bientôt plus qu’un. Le narrateur essaie de comprendre son père engagé à dix-sept ans : « Pourquoi s’engage-t-on à dix-sept ans ? », la faute du père éclaboussant le fils, tâche indélébile gravée sur lui, (« Sourire de niais, de ravi permanent qui ne sait pas qu’il a une tache dans le dos »), le regard d’autrui. Il tente de donner un sens à la cruauté, à l’incompréhensible, à l’inimaginable, au monstrueux, aux « récits inavouables. De cette histoire irracontable (…) ». La pauvreté laide et sale engendre la haine : « Quand on est pauvre, on devient méchant ». Au sein d’un groupe devenu violent, destructeur, mortifère, l’individu perd son identité, sa liberté. Thanatos emporte l’être humain « normal », moyen, quelconque : « Je ne suis pas comme ça. Je n’étais pas comme ça. Mais on l’a fait (…) C’est quelque chose d’aveugle, de furieux. Ça se fait au milieu des autres. On n’est plus qu’un seul corps monstrueux. Sans tête ». Violer, tuer, ne plus voir celui qui est en face comme un être humain. Plonger « dans un autre monde. Pas dans la réalité ». Plus rien n’a de sens, ni la vie ni la mort. Le narrateur subit le passé tragique de son père, lance un cri pour essayer de s’en dépouiller : « Non ! / Je ne suis pas concerné. C’est son histoire, pas la mienne. », rongé par l’inquiétude de ce qu’il aurait pu commettre dans les mêmes circonstances : « En quoi suis-je différent ? N’aurais-je pas fait pareil ? Ouvert, moi aussi, la porte sur le noir ? Aurais-je commis le pire ? Pas sûr que non ».
Le Carré des Allemands, livre émouvant, bouleversant propose une vision sombre de l’Homme, de l’existence. Mais, pour paraphraser Baudelaire, de cette boue naît de l’or : un roman où littérature, poésie, sociologie, Histoire se lient. L’intertextualité nourrit le sens du texte, le plonge dans la littérature, la poésie, la mythologie. En effet, des figures mythologiques (Les Euménides), bibliques (Salomé, Jean-Baptiste, Caïn), cinématographiques (Fritz Lang), poétiques (Rimbaud) se mêlent au récit. Cet ensemble intertextuel ouvre l’horizon de la narration et fait accéder l’histoire personnelle à l’universel.
Par Annie Forest-Abou Mansour, docteur ès lettres.
Ce livre, j'ai d'abord pensé que je ne l'aimerais pas : un héros austère, vivant tantôt en semi-reclus dans un appartement glauque, tantôt parcourant la ville la nuit, racontant des bribes d'histoires sombres comme des cauchemars, des anecdotes cruelles et laides avec pour personnages des enfants monstrueux.
Et pourtant, à la fin du premier carnet (le livre en comporte cinq), j'étais conquise, tout commençait à prendre sens.
"Qu'as-tu fait à la guerre, Papa ?"
Terrible question qu'on ne peut pas poser à un père disparu.
Alors à défaut c'est lui-même que le héros questionne.
Pourquoi, comment, quel passé avait ce père, quel futur pour lui-même ? Bourreau, victime, hasard, malédiction, le héros du livre essaie tous les rôles, cherche toutes les explications, aucune situation n'est confortable et surtout pas celle de fils d'assassin. .
Le style est magnifique, il y a des phrases toutes petites qui contiennent tous les possibles : destin ou libre-choix, acceptation, culpabilité, le poids de la faute des parents, juger ou excuser ...
Lecture éblouissante et douloureuse.
Le soir même, un père de trois enfants tuait quatre vingt quatre personnes à Nice.
Adele Binks sur Babelio 18 juillet 2016
© Jacques Richard - Tous droits réservés Dernière mise à jour : février 2016
Scènes d'amour et autres cruautés
Un tout petit mot pour te dire que j'ai A D O R É tes Scènes d'amour et autres cruautés. J'ai adoré cet univers aiguisé et insaisissable que tu construis pour mieux le déconstruire, ces anodins et effroyables rituels, ce trouble, ces glissements, ces dérapages que tu tricotes dans un humour cinglant avec une précision de Parque... Un chef-d'œuvre au charme frissonnant !
Corinne Hoex
Vous voudriez savoir ?
« Vous voudriez savoir ? On ne sait pas, voilà ! » Cette réplique un peu brusque pourrait être reprise par la plupart des protagonistes de ces courtes nouvelles, qui s’attardent avec prédilection dans ces zones floues où objets et phénomènes se confondent. On tente d’y cerner une sensation inédite — « c’est un peu comme de la musique qu’on verrait au lieu de l’entendre » — « comme le souvenir de quelque chose qui n’est pas arrivé » — « un spécimen dont il est difficile de parler » — « c’est indéfinissable, mais on reconnaît ceux à qui c’est arrivé sans le moindre doute ». Mais l’important n’est pas de savoir ce dont on parle : c’est d’y réagir.
La nouvelle se situe dans l’optique des personnages, qui savent, eux, de quoi ils parlent, le redoutent, ne veulent pas le nommer. Tout risque de recommencer, s’inquiète celui-ci. Quoi ? « Comme l’an passé, comme avant “ça”. » Et de ne rien savoir est peut-être pire encore... On tente de deviner : les « cicatrices laissées par les chars » sur le macadam nous entraînent sur une piste, l’enseigne rouge d’un restaurant libanais semble planter un décor, mais est-il compatible avec les cerisiers japonais ? Le décor, d’ailleurs, est souvent difficile à cerner. À la télévision, les visages sont floutés. Au bureau, les projecteurs rendent tout irréel. Tout concourt à dissuader la quête d’un sens précis.
Pas plus d’histoire que de décor. « Il n’y a rien à trouver dans la chambre. Seulement voir. Dans cette histoire, il ne se passe rien. » Pourtant... Il y a les bœufs qui sortent de la cuisse d’un homme... La pharmacienne qui distribue de dangereuses pilules... La créature qui engloutit les passants et les restitue en parfaite santé, sinon une légère odeur... Pourquoi ? On ne sait pas, voilà. Et tout semble normal. C’est cela qui fait le charme de ces histoires : nous sommes, au fond, dans la vie quotidienne, mais quelque chose a dérapé, qui semble normal à tout le monde, sauf au lecteur. Et il ne saura pas de quoi il s’agit.
Pour mettre à contribution l’imagination du lecteur, Jacques Richard utilise avec bonheur toutes les nuances de l’implicite, du présupposé qui implique ce qu’il refuse de dire (« Parfois personne ne tombe » implique bien que, le plus souvent, il y a des victimes !) jusqu’à la suspension suggestive de la phrase (« celui qui voulait que »), en passant par le sous-entendu, qui joue sur les registres lexicaux (« brouter » ne se dit que pour un végétal). Mais le lecteur qui croirait pouvoir décrypter ce qui n’est pas dit explicitement se heurterait à des contradictions permanentes. « Ils viendraient et me brouteraient » : s’agit-il d’une fleur qui redoute le passage d’herbivores ? Oui, si l’on remarque le « déraciner » qui vient un peu plus loin. Non, car « Il me gratte la tête », quelques lignes plus bas, fait plutôt songer à un animal. Ou à un homme, puisqu’il évoque son couteau à poisson. Nous n’en saurons rien, mais est-ce important ? L’essentiel est dans ce sentiment trouble, entre peur, complicité et désir qui le lie à... mais à qui ? À « lui » bien sûr... « celui qui le faisait, celui qui voulait que ». Non, décidément, il vaut mieux ne rien vouloir. On ne sait pas, voilà.
Alors, le lecteur se construit son histoire. Elle est effrayante, humoristique, désarçonnante, surréaliste, à son goût. Un couple se promène sur le bord de la table comme au bord d’un précipice. Des infirmières punissent les patients qui ne mangent pas leur purée selon le rite établi. Les éboueurs ne ramassent plus les corps, que l’on doit conserver chez soi. Il n’en resterait qu’une impression de malaise si l’écriture à la fois très souple dans la syntaxe et très précise dans le vocabulaire ne nous accrochait pas au fil ténu du récit. De belles formules, presque sentencieuses, un peu mystérieuses — « La crainte est la sœur grise de l’attente » — « non, je n’ai pas de cœur ; j’ai balancé le dernier qu’on m’a offert ». On ne sait pas, voilà, sinon qu’on en retire un plaisir frissonnant, bien réel, lui.
La dernière partie, qui a donné son titre au recueil, est d’un autre ton, plus lyrique (les alexandrins reviennent sournoisement), même si elle est parfaitement intégrée dans la structure très stricte du recueil. La nouvelle se referme sur le couple, avec ses épiphanies, ses peurs, ses tendresses. L’auteur y joue davantage sur le sens des mots, parfois précisé entre parenthèses, pour finir sur cette superbe notation, qui pourrait constituer une des clés du recueil : « Elle le regardait parler des mots ». Car Jacques Richard est aussi peintre : peut-être apprendrons-nous à écouter ses tableaux ?
Jean Claude Bologne, écrivain, octobre 2015
D’une limpidité opaque
Scènes d’amour et autres cruautés est une expérience littéraire unique. Jacques Richard, à la manière d’un peintre sur-réaliste, fait surgir des images extra-ordinaires, pièces d’un puzzle éclaté où tout ne s’emboîte pas de soi. Le processus de familiarité qui installe classiquement le lecteur dans un univers fictionnel ne fonctionne pas ici. On est dérangé, poussé hors de notre zone de confort. On pense comprendre, puis non. On pense voir, puis non. On pense saisir, puis non. On pense… On pense beaucoup trop. L’impératif du lâcher-prise s’impose. Car, dans un mouvement d’une fluidité extrême, d’une virtuosité confondante, Jacques Richard fait glisser de consciences en voix, de sujets en objets, de vibrations intimes en distantes extériorités. Comme si de rien n’était.
Dans ce recueil de percées, Jacques Richard interroge, aussi finement que simplement, les certitudes, le rapport à la Réalité. Le décor est familier, la description est minutieuse, pourtant le référent s’enveloppe d’étrangeté. Et le monde de devenir questions. Ainsi, dans cette salle d’attente, le garçon moite est-il humide ou parcellaire ? Dans cette chambre vide, la dame chargée du nettoyage, de dos, possède-t-elle un recto ? Une fillette rechigne à rentrer chez elle, quelque chose de rose passe, ne reste d’elle qu’une corde à sauter vert fluo ; cela atteste-t-il pour autant un lien de cause à effet ? Le petit soldat en campagne au milieu des ciguës et des chardons, cherche-t-il un couteau de fortune, un morceau de plastique bleu, une part de lui-même ? À table, les enfants se tiennent-ils tous sages comme des images ? La quinquagénaire, à bout de paroles, seule dans sa cuisine, ressent-elle aussi la crainte, « sœur grise de l’attente » ? Qui dévore qui lorsque l’on annonce « Je vais te manger » ? Cet employé modèle, évoluant dans un vivarium carton-pâte jaune et bleu, qu’éprouve-t-il ? Où se trouve Stamboul ? Et, en définitive, à quoi bon ces considérations, car ne peut-on pas « disparaître de la réalité ou y rester, sans que cela change rien. Y être et n’y être pas en même temps, comme dans la vie de tous les jours » ?
La vie a une fin, certes, mais toutes les histoires ne connaissent pas de chute. Certaines histoires n’ont pas d’histoire. Si bien que l’on s’efforce d’émailler le quotidien de rituels afin de se réapproprier un pan de réel. Même si l’on sait, au plus profond de soi, que le Réel demeurera en perpétuel décalage, à l’instar d’un cliché d’un View-master : « Les deux images apparentes ont l’air identiques, mais elles sont légèrement décalées et c’est ce qui donnait du relief au trois petits cochons devant leur cabane. Ici non plus, on ne perçoit pas immédiatement les différences, mais elles créent une certaine gêne, une sorte d’inconfort tant qu’on ne s’est pas rendu compte. […] Je vais me reprendre et le monde sera un. En relief sans doute, mouvant, précaire, infidèle, mais un.»
Grâce à une langue d’une précision chirurgicale, affûtée mais nullement affétée, les phrases de Jacques Richard revêtent une dimension peu commune : elles échappent. Elles coulent, cadrées, impeccables et implacables ; puis, parfois, sans crier gare, elles s’affolent, happées par un courant contraire. Cette curieuse allure confère texture à des atmosphères singulières, connectées par une intertextualité serrée… tout en non-évidence. Il y a donc de la Poésie dans le Réalisme de Richard. Pas du poético-vaporeux, mais de l’inconsistant sublimement consistant, de la limpidité opaque. Il y a également des doutes quant au matériau même de la communication : le langage, vecteur d’inadéquation, de trahison et de révélation : « Comme telle peinture, dans quoi nous avons plongé longtemps, nous donne pendant un instant, au sortir de l’exposition, le regard que le peintre a posé sur le visible. Une sorte de lucidité suraiguë, de perspicacité foudroyante, mais qui n’est pas nôtre et que les mouvements ordinaires de nos yeux, de nos corps, de la rue dissipent presque aussitôt. »
À rebours d’un saint Thomas, Jacques Richard nous enjoint à voir ce qu’on croit, ou du moins croire plus loin que ce que l’on voit. Il n’y pas un sens caché, juste le mystère des choses, des êtres, de l’existence : « Mais si… Non. Oui et non. Puisque vous y tenez, disons que c’est un peu comme de la musique. De la musique qu’on verrait au lieu de l’entendre. Un de ces airs qui vous trottent en tête et qu’on ne retrouve pas quand on veut les chanter. Vous savez, ça n’a pas toujours été là et un jour, sans doute, ça s’en ira pour de bon. Aussi, pourquoi voulez-vous que cela ait du sens ? » Une page se tourne, l’histoire se relit.
Samia Hammami, Le Carnet et les Instants
Jacques RICHARD, Scènes d’amour et autres cruautés,
Zellige, « Vents du Nord », 178 pages, 18,50 €.
L'homme peut-être et autres illusions
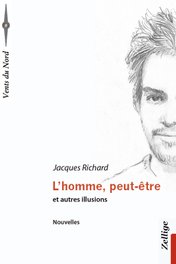
Jean-Claude Bologne
« On ne sait pas pourquoi. C’est comme ça depuis deux semaines. On ne sait pas non plus comment c’est arrivé. C’est là, au jour le jour, irréfutable, éclatant, sans qu’on puisse s’y soustraire en aucune façon, même en restant chez soi. » Ce départ de la onzième parmi trente courtes nouvelles résume tout le charme de ce recueil. Une incertitude, d’abord, sur le monde qui nous entoure. Au détour d’une phrase, une notation subreptice, que l’on peut négliger, la première fois, crée un léger décalage, un doute sur la réalité de la situation et, peu à peu, un malaise : "En principe, je ne crois pas, on nous a dit après, il ne semble pas, à sa connaissance..." Sommes-nous bien là où nous pensons être ? Voyons-nous vraiment ce qu’il nous semble voir ? Et sommes-nous réellement ce que nous croyons être ? D’autres notations, immédiatement, nous projettent à l’inverse dans un univers d’évidence : "Bien sûr, naturellement, tout le monde sait bien... " On pense à des photographies de Man Ray, à des tableaux de Bogaert, qui parvenaient à engendrer le malaise dans un univers aux contours nets, sans que l’on parvienne à en identifier la cause.
Car nous sommes dans un monde quotidien, un trajet en voiture, une chambre à coucher banale, les premiers pas d’un enfant... Et soudain, quelque chose arrive dont on nous dit que c’est tout à fait normal, sinon que cela n’arrive jamais dans notre monde. Alors il faut mettre en doute la réalité, qui n’est peut-être qu’une « possibilité d’existence parmi de nombreuses », dans laquelle on se trouve confiné
« non par choix personnel, bien sûr, ni par la volonté d’un autre hypothétique, mais plutôt par le jeu d’un hasard ou d’une plaisanterie ». Parfois, ce sont les mots qui se substituent à la réalité visuelle. Parfois, c’est la porosité entre deux mondes parallèles qui remet tout en question, « comme un souvenir qui tente de percer à travers les strates d’une mémoire incertaine ou rétive ». Une tête qui dépasse en riant d’un champ de maïs fait soudain déraper le paysage, et c’est notre identité même qui en est bouleversée.
Tout cela ne constituerait qu’un bon recueil de nouvelles fantastiques, si cette remise en question du monde ne passait par un formidable travail sur l’écriture et sur les nuances de la langue. Un jeu sur les présupposés (« elle riait encore »), sur le mot propre (le groin pour une femme), sur l’usage des temps (un imparfait où l’on attendrait un passé simple), sur la répétition d’une phrase ou d’un même paragraphe... De merveilleuses formules traduisent l’intériorité profonde du personnage face à un monde qui se dérobe : « Elle regardait dans ses paupières closes » , « Son sourire prenait tout son visage et l’emmenait à l’intérieur d’elle-même, retrouvée, enfin, tout entière. »
Surtout, c’est la construction même du recueil qui fait sens. Pourquoi la première partie s’intitule-t-elle « Miroirs », quand cet objet n’y apparaît guère ? C’est qu’elle est tout entière construite sur un procédé spéculaire, qui fait correspondre la première nouvelle à la quinzième (une photo prise par un intrus dans la chambre), la deuxième à la quatorzième (ambiguïté entre un enfant et un animal), et ainsi de suite (faisons confiance à la sagacité du lecteur) jusqu’à la huitième, qui sert de pivot, la plus mystérieuse, la plus poétique, qui fait de la femme observée un miroir d’elle-même (« quand tes lèvres cesseront de t’embrasser les lèvres »). La subtilité et la maîtrise de ce premier recueil, de la composition à l’écriture, en font un petit bijou à savourer point par point.
Le plaisir du texte ( www.leplaisirdutexte.com )
Coup de cœur :
L’homme, peut-être et autres illusions de Jacques Richard aux éditions Zellige
(…) Tout le monde sait bien qu'il ne faut pas regarder. Mais c'est toujours quand c'est fait qu'on se dit qu'il ne fallait pas. Le temps que je me reprenne, il n'y a plus rien (…)
Ce recueil de nouvelles se reçoit comme trente invitations à lâcher les fils qui nous lient à la réalité pour aller vers d'autres rives moins fréquentées.
Celles d'un monde sensoriel et intérieur où personnages et narrateur se rencontrent, se (con)fondent dans un univers 'revisité', aussi étrange qu'instantané.
Utilisant l'humour, (cf. 'Chien qui revient' … dans la peau du narrateur), la tension dramatique, (cf. 'Chose' qui suit le lent désinvestissement d'un corps féminin offert au plaisir), ou encore basculant dans le fantastique, (cf. 'Dans un paysage', où une tête est aperçue (ou réaperçue?) parmi des épis de maïs (…) (…) Elle est dans ma réalité (…) Nous nous croisons. Elle m'apparaît et je lui apparais. Je suis une tête qui dépasse en riant d'un champ de maïs.
L'écriture de Jacques Richard se libère et s'épure comme un geste méditatif se transforme au fil des nouvelles perceptions du personnage ou du narrateur dans le cours de l'histoire, comme l'abstraction d'un tableau convie le spectateur à se fondre dans ses formes et couleurs, (…) comme ces personnages qui, entre veille et sommeil, nous visitent, ces visages qui ont une présence, une réalité bien plus dense que les habitants de notre quotidien (…)
Ajoutons-y notre plaisir personnel et professionnel de la découverte de ces textes courts et percutants qui incitent directement à la lecture de vive voix, à un partage de sensations, à un basculement vers d'autres états de conscience si on s'y laisse conduire…
Bref, un livre qui laisse des traces…
Marie-Christine Duprez
L'Echo, 7 juin 2014
Une troublante opacité
Dès les premières lignes, on a la certitude d'avoir affaire à un écrivain. Non pas quelque habile auteur, heureux dépositaire d'histoires trouvées ou ingénieuses. Il fut d'ailleurs sur la liste du dernier Rossel, pour «Petit Traître». On entre dans les nouvelles de Jacques Richard en poussant la porte d'un songe. Quelque chose, est là, immobile. Quelqu'un qu'on n'avait pas vu. Comment est-il entré, qui est-il? Le sait-il lui-même? Courtes, parfaitement composées, ces nouvelles tracent un sentier dans le brouillard et interrogent notre étrange présence au monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Nous sommes à la fois le pourquoi et le rien, l'accompli et l'inexpliqué. Jacques Richard a le talent de percevoir, non pas le mystère, mais ce qu'il y a de familier dans l'inattendu. Ce qui trouble, est cette impression d'entrer sur ses pas, dans l'instant de ce qui attendait un regard pour exister.
Partant de faits anodins, un voyage en train, un déjeuner entre amis, une promenade en forêt, une vieille photo, Jacques Richard glisse un pied dans les gonds de la réalité pour démêler le réel, de ce qui se rêve là. Il en est à la fois le témoin et celui qui est rêvé, par lui-même ou un autre. Et le vertige surgit. Le loup des contes de Grimm entre dans cette brèche, et l'inquiétante étrangeté l'est d'autant plus qu'elle ne nous est pas inconnue, mais renvoie aux peurs ataviques du gouffre, de la mort et de ses chausse-trapes. On y entre, confiants pourtant, attentifs à ce rideau trop rouge, à cette humidité de l'air, qui laissent présager une tranquillité en sursis. Le narrateur est rarement seul, et pourtant il est le seul à voir ce que sa compagne ou celui qui chemine a ses côtés n'a pas senti, et cette solitude de la perception accroît l'angoisse chez le lecteur.
Jacques Richard qui est peintre et musicien, écrit en coloriste, dominant à la fois le récit et le contrepoint, usant d'une touche de carmin, d'outremer ou de noir profond, pour faire chanter la matière. C'est par la matière, et non l'idée, qu'il compose ses nouvelles, qui laissent passer, sans s'y attarder, un au-delà, un en deçà, un sous-sol de l'entendement. Quelque chose a surgi qui reprendra aussi vite sa place, anodine, dans le décor. En demeure la trace, et une présente absence. Les personnages eux-mêmes ont conscience d'être regardés, de faire image dans le paysage, alors même que personne ne les regarde. Et pourtant..., «cette tête maigre et rouge» dans le champ de maïs, «dépasse au ras des épis et me suit du regard en riant fixement.»
Les nouvelles de Jacques Richard ont ce quelque chose des peintures contemplatives et flamandes de Valérius de Saedeleer, trop sages, qu'un Léon Spilliaert reprendrait d'un fusain tremblé. On reste pantois devant une telle maîtrise, qui met en concordance de temps l'avant et l'après, la réalité et son double, l'irrésolu dans le fini. Avec en clé de voûte, l'enfance sauvage, la belle enfance, qui résonne encore, et en écho l'infini pourquoi de son injuste exil.
Sophie Creuz
,La Libre Belgique, 3 mars 2014
Où est le réel ? Où est l’illusoire ?
Jacques Richard plonge son lecteur dans le désarroi. Une prise de distance.
Jacques Richard est peintre depuis quelque quarante ans et a une formation de musicien. On ne peut faire abstraction de ces deux modes d’expression qui lui sont habituels lorsqu’il s’implique dans un troisième : la littérature ralliée en 2010 avec "La plage d’Oran", ensuite avec "Petit traître" qui l’inscrivit en 2012 parmi les finalistes du prix Rossel. Tout, dans son écriture, respire la poésie et la musique. Il est toutefois difficile de le rattacher à un genre littéraire précis tant s’imbriquent, notamment dans son récent livre, "L’homme, peut-être… et autres illusions", la nouvelle, le récit, le fantastique, la poésie… C’est à travers mots, images, couleurs, impressions et rythmes des phrases qu’il interroge un certain nombre de réalités familières pour les renvoyer déformées, rêvées, inattendues, plongeant le lecteur dans une sorte de désarroi intranquille. Voit-il ce qu’on lui fait voir ? Voit-on ce que l’on croit voir ? Dit-on, comprend-on, ce que suggèrent les mots employés pour dire ? Où est le vrai ? Où est l’illusoire ? Les évidences de la narration semblent s’inverser au fil du langage. Quelque chose change sans que l’on puisse clairement en déterminer les pourquoi et comment. Dans une sorte de déplacement de perspective ou de prise de distance, on perçoit différemment le cercle étroit des certitudes que l’on avait.
Tout cela semble compliqué. Ce l’est. À moins de s’abandonner, sans s’accrocher à la logique, à l’étrangeté des courtes histoires qui se succèdent. Chaque nouvelle capte un moment de vie réelle pour le réfléchir dans un jeu de miroirs qui bouscule les convictions ou les attentes que l’on pouvait avoir. En nous faisant monter d’un cran ou en nous projetant dans un face à face grossissant, la narration se dilue pour faire place à une sensation - ou impression - de flou, de mystère, d’indéfini… On est soudain ailleurs. Ce peut être dans un absurde qui, dans une situation inverse, n’est pas étranger à un Raymond Devos lorsque, dans le texte "Chien qui revient", un être humain se mue peu à peu en animal. La frontière est mince entre le connu et l’inconnu, entre le regard que l’on porte sur les autres et celui dont on a tendance à ne pas se voir, significativement illustré par "Le cadre en argent noirci".
La réflection renvoie ici à la réflexion. Mais il ne faut pas y aller avec des a priori. Il faut se laisser surprendre par quelque chose que l’on perçoit sans que les sens ou la logique semblent y participer. "Cela semble s’adresser à une autre partie de mon entendement". Une écriture simple et épurée, très visuelle, traversée par le silence des ellipses et par une scansion classique qui donne à l’ensemble un rythme musical accaparant constituent un atout composite de cette variation. Insolite.
Monique Verdussen
Pierre Maury, Le Soir, 22 février 2014
Nouvelles
L’homme, peut-être et autres illusions ✶✶
JACQUES RICHARD
Point, contrepoint. Le jeu de miroirs, toujours subtil, devient parfois spectaculaire. Prenons, par exemple, la nouvelle d’ouverture et la quinzième, qui clôt la première partie. Entre les deux, des personnages, des décors, des situations nous ont peut-être fait oublier le début.
Mais voilà que l’auteur nous y renvoie avec la force de sa persuasion, augmentée d’un ton ne laissant aucune place au doute : voici bien un écrivain de belle tenue, et son troisième livre est aussi le plus abouti.
Guy Bernard, La dernière heure, 13 mars 2014
Jacques Richard, l'exigence faite homme
Bruxelles “La contemplation est essentielle en ce que c'est le monde qui vient vers nous.”
Ad vitam fécond. Tel s’inscrit à jamais le 20, rue de la Luzerne. En des temps peu reculés, nous vous y avions emmenés à la découverte de Pascale Toussaint, excessivement inspirée par Louis Scutenaire, l’illustre et surréaliste maître des lieux. Divin détour n°2, à la rencontre de l’homme, sûrement : Jacques Richard, artiste absolu et époux de l’auteure.
Véritable météorite des lettres de chez nous, le Schaerbeekois sort, en 2010, de l’anonymat littéraire avec La Plage d’Oran, un bijou qu’il aura mis cinq ans à polir. "Je me sens toujours Algérien", confesse l’intellectuel en songeant, tout à la fois, à ce récit premier et à l’avant 1960, date de son arrivée en Belgique.
En 2012, le peintre, professeur au CAD, une école uccloise des arts graphiques, est retenu parmi les finalistes du Rossel. Excusez du peu ! Et son Petit Traître de lui conférer une reconnaissance sur laquelle ce roi de l’ellipse jamais ne se repose : "Un artiste doit semer le doute, mettre le doute au cœur du débat de la cité. Ce doute me semble une nécessité absolue", narre notre hôte, alors que ses nouvelles, L’Homme peut-être et autres illusions plonge le lecteur dans un univers dont l’on pourrait vouloir ne s’éloigner jamais.
C’est que l’adepte des séries, des thématiques aussi (l’absence, le doute, ici; l’attente en une future production fleurant la frénétique impatience), le "grand défenseur de la chose écrite" prône l’exigence : "On ne peut absolument pas brader la qualité sous prétexte qu’on a affaire à des gens moins cultivés".
Contemplatif dans l’âme et les mots, Jacques Richard sert ce "mode de vie" dans chaque virgule, chaque trait de pinceau -infiniment délicat- de son talent, si multiple.
Et Bruxelles, d’y gagner mille fois, dans ce besoin de "tendre vers l’impossible"... "Lorsque mon fils, de 22 ans, m’a dit adorer Bruxelles, je l’ai regardée autrement", confesse Jacques Richard. Dans les trois pages de Drame, par exemple, il décrit, "avec beaucoup d’affection", le parc de Tervueren. Ou, ailleurs, la rue Neuve. Du bonheur! Pur.
L'avis des lecteurs
Postez un commentaire ici. Je vous répondrai avec plaisir.
...apparition d'un monde d'écriture nouveau.
Ces nouvelles ignorent les noms donc les personnages au sens classique, et leur magie vient de ce qu'ils naissent d'accident de l'attention ou de l'inattention quotidienne, visuels ou sonores, comme si on mettait à chaque fois le pied dans une fourmilière. En somme le narrateur est celui qui met le pied dans la fourmilière visuelle et sonore que nous appelons "vie" pour nous rassurer en unifiant, même quand nous disons que "la vie est dure", que "la vie est difficile". Il y a dans ton livre un thème philosophique riche que tu développes comme un thème musical. Il me semble que la très belle musique de tout le livre, beaucoup plus sourde et continue que celle des deux précédents, est une sorte de mise en scène de ce que les psychanalystes appellent "attention flottante", une des rares expressions que j'aime dans leur vocabulaire, l'attention qui s'organise à côté pour capter les dissonances. Et je trouve très pertinent que tu appelles nouvelles ces petits drames nés de la perception des dissonances quotidiennes.
Dominique Tassel, éditeur
Je viens de terminer ton livre "L'homme, peut-être", un ensemble très cohérent de beaux textes, que j'ai ressenti comme autant d'invitations à la méditation. Tu as l'art d'entretenir une certaine forme de mystère qui me fait penser au réalisme magique cher à certains écrivains belges. On perçoit aussi la dimension philosophique à l'oeuvre dans pas mal de textes. Ces textes sont aussi très visuels et l'on ne s'étonne pas que des personnages de photographes, de peintres surgissent ici et là ou la thématique du miroir, de l'image, etc. J'ai apprécié aussi l'humour de récits comme Chien qui revient. Deux textes ont particulièrement retenu mon attention: Miroirs et Vestiges. Je trouve que chaque texte pourrait être accompagné d'une peinture, car une peinture est ce fragment de temps que dit chacune de tes nouvelles, ainsi que d'une musique, à tel point que je me suis imaginé déambulant dans une exposition qui allierait chaque texte à un tableau, ainsi qu'un morceau de musique.
Michel Torrekens, écrivain.
J'ai été happée par ton écriture, qui suggère et n'appuie pas. Qui fait naître parfois le malaise sans qu'on ait identifié la cause, exactement comme le ressentent les protagonistes de tes nouvelles.J'ai particulièrement savouré "Exil". Je l'ai relue deux fois de suite, rien que pour le plaisir. Et j'ai été éblouie (si si!) lorsque, lisant la dernière nouvelle de la première partie, j'ai réalisé que toute cette partie était construite en miroir. Là, j'ai fait une pause, juste comprendre, goûter, les nouvelles sous ce nouveau jour. Merci pour ce moment de lecture de qualité, Jacques !
V. Hanoteau, éditions OnLit
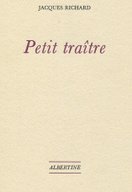
Petit traître
Presse
Ecoutez Jacques Richard au micro d’Edmond Morrel - Novembre 2013
Le Jury Rossel ne s’était pas trompé en retenant parmi les finalistes du dernier Rossel (2012) le Petit traître de Jacques Richard. Voici un livre qui allie et entrelace la poésie, la musique et la peinture pour donner naissance à une écriture lumineuse, et éclairer l’évocation d’une enfance prisonnière.
Ce bref récit évoque en chapitres courts les images d’une enfance algérienne passée dans un centre d’accueil. L’enfant prisonnier est placé face à l’incompréhension, l’injustice que lui inspire son internement. De l’autre côté de la grille, sa mère vient le regarder lorsque les intervalles entre les visites réglementées sont trop longs. Il a fallu à son auteur près d’un demi-siècle pour se décider à l’écrire et ainsi échapper à l’indicible. Mais aussi accéder à chacun d’entre nous.
Cilquez ici et écoutez Jacques Richard au micro d’Edmond Morrel
Francine Ghysen, Le Carnet et les Instants, mai-juin 2012
Avant tout, par-dessus tout, il y a les murs. Étouffants, oppressants, implacables. « En rang, à la promenade, on emporte les murs, on est habillé avec. » « Être derrière le mur, c’est se trouver devant et ce qui est derrière ne peut pas exister. Une matière qui sépare, du construit qui détruit. »
Les murs et la grille qui coupent les enfants de la vie au-dehors : les palmiers, les figuiers, les mimosas brûlés de soleil, le port, la mer, les gens qui vont et viennent en toute liberté sur les trottoirs et ne savent rien de ce monde clos, pension qui tient de la prison, où un petit garçon tente de trouver un sens à ses jours. Entre la classe, le réfectoire, les jeux dans la cour, le dortoir rose où sont cantonnés les petits qui mouillent encore leurs draps ; les brimades du surveillant Fernand, la violence des enfants qui se liguent parfois tous contre un, prenant sur ce souffre-douleur leur revanche de gosses abandonnés.
Alors, il s’invente des rêves, se raconte des mensonges, petit traître qui cherche à s’échapper d’un quotidien aride, mais devine qu’au contraire « Il faut cesser d’espérer pour pouvoir continuer. Il faut s’habituer. À tout. À tout ce qui est ici, à tout ce qu’on fait ici. S’habituer […] au mal de chaque jour. »
Même les visites de la mère, tant attendues, guettées, sont un tourment autant qu’un bonheur. Parce qu’elles sont trop courtes et qu’on scrute anxieusement le cadran de sa montre : « C’est quand la grande aiguille sera arrivée où, que tu vas partir ? » Parce que les mots tendres, les gestes doux ne sont pas de mise ici : on ne parle plus la même langue, on ne parvient pas à se rejoindre.
Le deuxième livre de Jacques Richard (après La plage d’Oran, l’an 2010) renoue avec son enfance algérienne. Récit âpre, poignant, qui cerne par brèves séquences le vide affectif, l’absence béante qu’endure un enfant, ses questions muettes, ses peurs, son désarroi. « - Ton père, il est où ? Il voulait plus de toi ? Des fois c’est comme ça, ils nous veulent, et puis ils nous veulent plus. Même si on n’a pas fait quelque chose. Et alors on est mis ici. »
Ce père qui court le monde, traquant la vie qu’il faut saisir à bras-le-corps, dans l’immédiat, à même la terre, affirme-t-il, et pas dans les mots, qui sont « des peaux mortes ». Pour lui, « écrire ça ne sert qu’à garder, conserver, se souvenir, se protéger. Mettre la vie dans les livres, c’est comme mettre l’argent, ce qu’on a, dans un coffre, ça ne sert à rien, à personne, et quand on veut s’en servir, apprendre à s’en servir, il est trop tard, ça n’a plus cours, la vie est passée, partie. »
Ne pas croire aux livres. Ne pas se consoler dans les rêves. Et pourtant, comment traverser ce désert, ce manque de tout, sans imaginer qu’un jour, ils ne seront plus qu’un cauchemar dont on se réveillera dans son vrai lit, à la maison, bercé par les bruits rassurants de la mère dans la cuisine ? Des images trop belles, qui s’effacent sous les larmes.
« Les sanglots des enfants font moins de bruit que l’eau qui joue dans les galets. » Mais ce bruit sourd, lancinant, d’une mémoire à vif, nous transperce le cœur.
Pierre Maury, Le Soir, décembre 2012
Petit Traître
Le retour à Oran
Les mots crissent sous les dents comme des grains de sable, et blessent de la même manière. L’enfant est retenu avec d’autres derrière « la grille ». Pension ou prison ? Même la mère ne peut le voir sinon aux jours prévus et encore. Dehors, il y a la guerre ou ce qui y ressemble. Cette guerre sournoise et les paysages secs évoquent l’Algérie sans jamais la nommer jusqu’à la dernière page où surgit tout à coup la ville d’Oran. Les brimades viennent des adultes mais aussi des enfants ; on souffre d’une violence qui semble presque naturelle et qui n’est pas moins douloureuse pour autant. La poésie de l’écriture n’est pas là pour dire le ciel, à moins qu’il ne soit d’un bleu qui crie avec la consistance de la peinture.
de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique
Extrait de l'argumentaire du jury
L’émotion est ce qui porte cet ouvrage, sans sentimentalisme, mais poignant par sa manière de vriller la solitude telle qu’elle se ressent dans le plus jeune âge, hyper-senisible et paralysé par l’impossibilité de porter soi-même remède à son sort. Jacques Richard est aussi musicien, et plasticien : son sens du rythme, du rapport des formes viennent-ils de là ? Le fait est que l’impact de ce texte, qui ne recherche jamais l’effet, mais ne laisse pas indemne pour autant, est prégnant.
L'avis des lecteurs
Hier j’ai acheté puis lu ton livre. J’en suis sortie bouleversée et je l’ai relu sur le champ.
Je suis dans la lecture des dernières pages de ton "Petit Traître" et ne peux faire d'autre commentaire que de dire que ce livre me prend aux tripes ... Très très fort ! Je te félicite pour ce magnifique, bien que très dur, morceau de littérature.
Je suis certaine que beaucoup de lecteurs ne trouveront pas les mots pour te traduire l'impact ressenti au fil de la découverte de "La plage d'Oran" et de "Petit traitre", un peu comme Ariane Lefort, d'ailleurs...
Vous méritez toute la reconnaissance possible pour votre talent mais aussi votre combat quotidien contre la médiocrité.
Je ne sais pas quel est l'état d'esprit aujourd'hui, mais je tiens quand même à te dire que je trouve magnifique d'avoir été sélectionné pour le Rossel et que Pierre Mertens que j'ai eu l'occasion d'interviewer hier, m'a dit texto à ton propos: "Jacques Richard: un don poétique complètement inné". Je tenais à t'adresser le compliment, qui te revient.




